Mon expérience avec les erreurs dans l’acquisition des langues
Avant toute chose, je vous demande pardon et je vous préviens. Dans cet article, je vais divaguer. Hablar pavadas, comme on dit en espagnol rioplatense.
Je parle quatre langues avec différents niveaux de compétence. L’espagnol, ma langue maternelle. L’anglais, que j’ose dire très bien, car je l’apprends depuis l’âge de neuf ans et c’est ce que m’ont dit les locuteurs natifs avec lesquels j’ai interagi en personne. De plus, je n’ai aucun problème à tenir une conversation normale. L’allemand, bien, car j’ai un examen de niveau C1 validé et j’utilise souvent la langue. Même si parfois mon cerveau doit fonctionner comme un ordinateur pour réussir à dire ce que je veux dire, en général, j’y arrive, même si je dois souvent (très souvent) recourir à des périphrases. Et quand mon interlocuteur dit en trois mots ce que j’ai dit en vingt-quatre… Et le français. Avec le français, en réalité, je suis en pleine lutte, et je dois reconnaître que c’est lui qui est en train de gagner. La prononciation est si difficile que je n’arrive pas à progresser, par exemple, avec le vocabulaire, moi qui parle espagnol, une autre langue romane. Mais si je devais partir en voyage en France aujourd’hui, je me débrouillerais sans trop de problèmes, du moins pour l’essentiel… si l’essentiel n’inclut pas d’utiliser le subjonctif.
Il y a quelques années, j’ai suivi un cours d’allemand à Dresde, en Saxe, en Allemagne. J’adore voyager et, lorsque je voyage, j’aime me mêler à la population locale pour essayer d’en apprendre davantage sur sa culture. J’aime aussi la bière brune, alors, un soir à Dresde, j’ai décidé d’aller dans un bar pour en boire une. Mon niveau d’allemand, à ce moment-là, était très bas, tout au plus un A2, et les Allemands sont des personnes très directes qui ne laissent pas passer les erreurs. Autrement dit, si vous faites une erreur, ils vous le disent. L’allemand a des cas grammaticaux, mais je ne vais pas expliquer ici ce que c’est, car cela me prendrait 800 pages. L’essentiel, c’est que les cas grammaticaux impliquent la déclinaison, c’est-à-dire que de nombreux mots changent en fonction de leur rôle dans la phrase. Pour donner un exemple, en anglais, «rouge» se dit red, et ça reste red dans tous les cas. En allemand, on dit rot, mais selon le cas grammatical, cela peut devenir rote, roter, roten, rotem ou rotes. Je crois que je n’oublie aucune forme. Mais c’est encore pire: certaines de ces formes peuvent être masculines, féminines, singulières ou plurielles, selon le cas grammatical. Autrement dit, «rojo, roja, rojos, rojas» en espagnol, c’est un jeu d’enfant.
Le fait est que je suis allé au bar et, à l’entrée, j’ai répété comment demander qu’on me recommande une bonne bière brune.
– Könnten Sie mir bitte ein gutes dunkel Bier empfehlen?
– Hast du dunkles gesagt?
Ce fut la réponse, avec un air peu aimable, parce que je n’avais pas décliné l’adjectif dunkel. Pourquoi cette anecdote? Parce que l’erreur fait partie du processus d’acquisition d’une langue étrangère. Et les humains n’aiment pas se tromper: cela nous rend nerveux, cela nous embarrasse. Le problème, c’est justement que l’erreur est inévitable. Lorsque nous apprenons une langue, nous ne pouvons pas attendre de la parler parfaitement pour commencer à l’utiliser. D’une part, parce que si nous ne l’utilisons pas, nous ne progresserons pas. D’autre part, parce qu’il est fort probable que nous n’atteignions jamais le niveau d’un natif. En fait, pour différentes raisons, si nous commençons à apprendre une langue étrangère à l’âge adulte, il est hautement improbable que nous acquérions la compétence d’un locuteur natif. Il existe une théorie selon laquelle, parmi les adultes qui commencent à apprendre une langue étrangère, seulement 5 % atteindront ce niveau de compétence linguistique. Et on les appelle les 5 % pathologiques. Ainsi, ce que je veux transmettre avec cet article, c’est qu’il ne faut pas avoir peur de l’erreur. Et si l’on ne peut pas éviter cette peur, il faut se tromper malgré elle. Et si l’on nous corrige, l’accepter. Après tout, les corrections nous aident à progresser, non?
Une autre stratégie – et en écrivant, je me rends compte qu’en partie, je suis en train de faire une catharsis – est de ne pas se concentrer sur les erreurs. Cela ne fait qu’augmenter le stress au moment d’utiliser la langue étrangère que nous sommes en train d’acquérir. Et ici, je vais me prendre moi-même comme exemple. Plus haut, je vous disais que, plutôt que d’apprendre le français, je lutte avec la langue… et que je suis en train de perdre. J’apprends des langues parce que j’aime ça, et ce que je préfère dans le français, c’est son son. J’adore la façon dont le français sonne. Mais moi, quand je parle français, j’ai un fort accent espagnol. Alors, je déteste la façon dont je sonne quand je le parle.
Pourquoi avons-nous un accent étranger lorsque nous parlons une autre langue? Il est très probable que, lorsque nous parlons une langue étrangère que nous avons apprise, nous ayons un accent étranger. Cela se produit parce qu’en acquérant une nouvelle langue, nous assimilons ses sons, son intonation, etc., en les rapprochant le plus possible de ceux de notre langue maternelle. Et bien que de nombreux linguistes me contrediraient et diraient que je divague (que hablo pavadas), de mon humble point de vue, l’accent étranger est la forme d’erreur la plus courante lorsque l’on parle une autre langue, et c’est aussi celle qui a le plus tendance à se fossiliser. J’ai lu de nombreuses explications sur ce qu’est la fossilisation des erreurs, mais celle qui me plaît le plus est la suivante: les erreurs fossilisées sont celles que notre cerveau choisit de ne pas corriger, car elles n’empêchent pas la communication. Parce que ce n’est pas strictement nécessaire. Et dans le cas particulier de l’accent étranger, dans la plupart des cas, ce n’est effectivement pas nécessaire. Ce n’est pas la même chose que de mal conjuguer les verbes, confondre le vocabulaire ou oublier les pronoms réfléchis: tout cela peut nuire à la compréhension. En revanche, prononcer les sons d’une langue d’une manière qui se rapproche de celle des locuteurs natifs n’est pas toujours indispensable pour se faire comprendre. Cela dit, revenons à mon français.
Comme je le disais, lorsque je parle français, j’ai un fort accent espagnol. La prononciation du français est très difficile : il y a, par exemple, des voyelles nasales qui n’existent pas dans ma langue, elle est remplie d’exceptions, et la liste est encore longue. Ainsi, il m’arrive souvent, lorsque je parle en français et que j’entends mon propre accent étranger, de me concentrer tellement
sur mes erreurs de prononciation que, d’une part, je ne trouve pas toujours les mots pour dire ce que je veux dire, car je suis entièrement focalisé sur le fait de m’écouter. Et d’autre part, je deviens tellement conscient que je ne prononce pas comme je le voudrais que je finis par encore plus mal prononcer. Alors, de mon point de vue, et en ce moment je me conseille à moi-même, perdons la peur des erreurs et concentrons-nous sur ce que nous faisons bien, plutôt que sur ce que nous faisons mal. Et faisons des erreurs: se tromper et être corrigé est aussi une façon d’avancer.


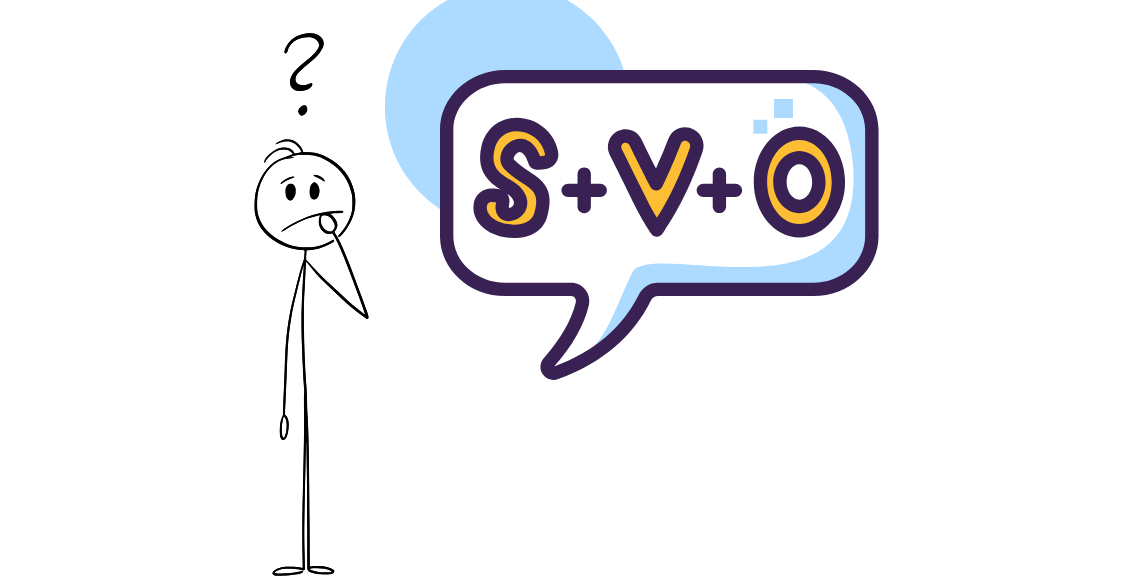

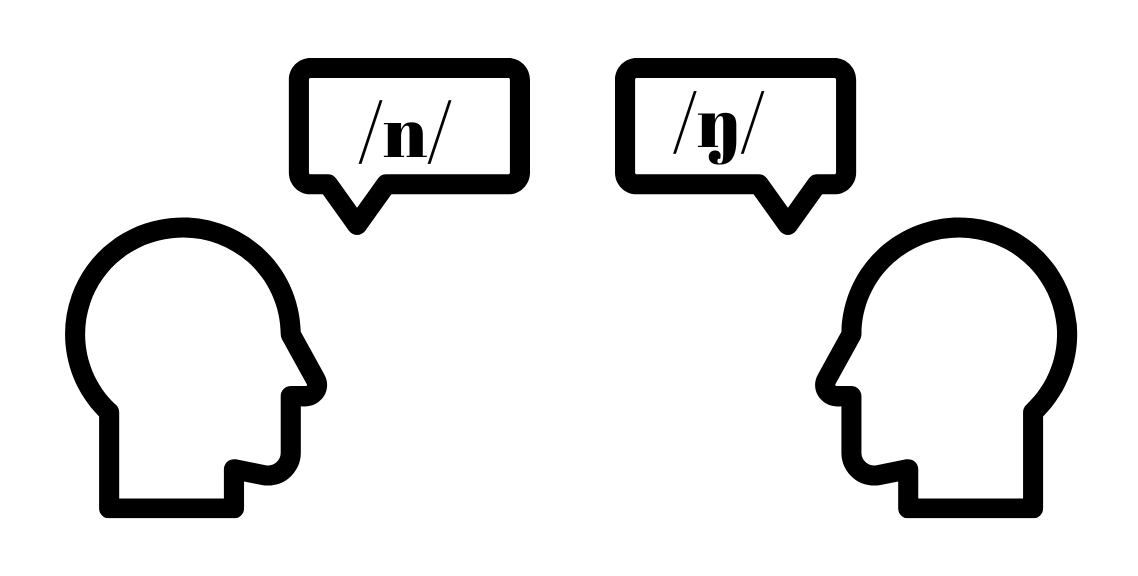
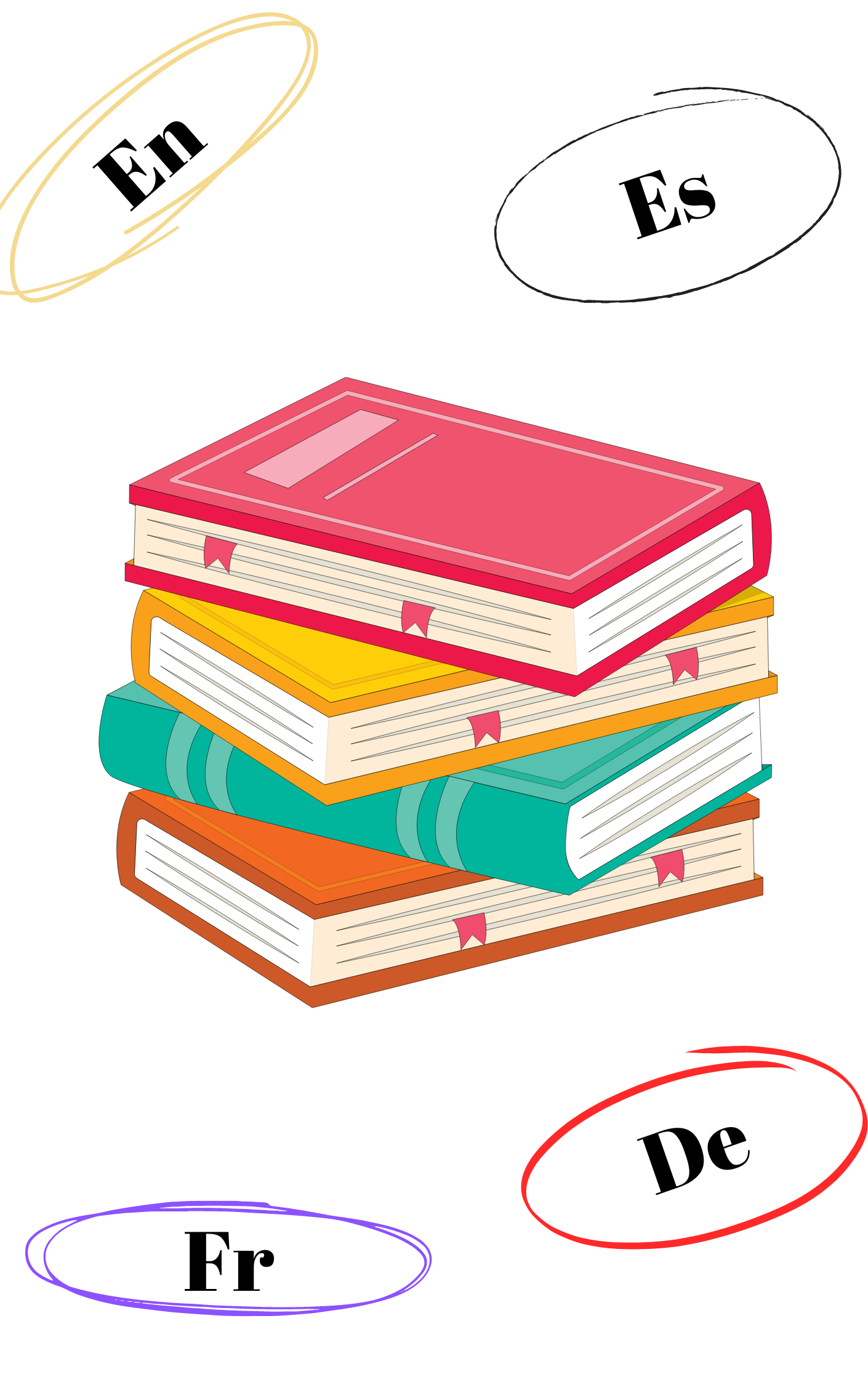
Laisser un commentaire